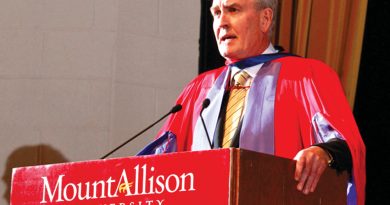SOLDATS BLESSÉS
Les policiers et l’état de stress post-traumatique
PAR MICHELLE GUBBAY
Au petit matin, un policier en patrouille poursuit un véhicule en fuite dans lequel se trouvent des personnes soupçonnées de vol à main armée. Lorsque le véhicule fait une embardée, et l’un des suspects en émerge et semble tenter de sortir une arme. Le policier lui tire dessus et le suspect meurt sur la scène; en examinant le cadavre, aucune arme n’est retrouvée.
Un agent poursuit un homme soupçonné d’avoir volé une bijouterie, l’acculant dans une cour d’école. Derrière le suspect se trouve une classe remplie d’élèves. Le policier ne sait pas si le suspect est armé; plutôt que d’ouvrir le feu, il parvient à le convaincre de se rendre. Il est félicité par son service, mais ses collègues l’évitent, le considérant un partenaire d’une fiabilité douteuse dans des situations dangereuses.
Une agente de transit, nouvellement employée, tente d’amadouer un handicapé mental près de l’étroit corridor longeant un tunnel de métro, afin que celui-ci puisse procéder en toute sécurité. L’homme l’attaque et l’abandonne au sol, grièvement blessée.
Un jeune policier est pratiquement tué alors qu’il poursuit des voleurs qui se sont emparés de biens d’une valeur de moins de 40 $. Il survit, physiquement indemne.
Un sergent d’état-major entend les cris angoissés d’un collègue, atteint par balle et retenu en otage par deux voleurs. Dans un premier temps, le sergent d’état-major s’abstient comme le lui ordonne son supérieur, mais ensuite, désobéissant aux ordres, il entre en action – mais trop tard pour sauver la vie de son camarade, au bout de son sang.
Une agente de police croit connaitre l’identité d’un tueur en série recherché, mais ne parvient pas à le prouver ni à procéder à son arrestation avant que d’autres femmes disparaissent et soient assassinées.
Six scénarios dramatiques… mais loin d’être des idées pour des textes d’émissions policières télévisées. Aucun de ces incidents n’a été imaginé, et les policiers ne sont pas des personnages fictifs. Chaque récit est une brève incarnation d’une série d’événements qui se sont réellement produits, impliquant de vrais policiers. (Voir l’encadré pour plus de détails).
Chaque situation est différente des autres : une fusillade mortelle et la décision de ne pas tirer; de graves blessures physiques et aucune blessure du tout; la proximité d’un collègue et ami aux proies avec la mort, et la mort distante de parfaites inconnues. Malgré la différence des scénarios, tous les policiers impliqués partagent cependant une même conséquence commune : ils ont tous, par la suite, souffert de trouble de stress post-traumatique. TSPT.
Le « trouble affectif du soldat » : un bref aperçu historique
En 2014, le « trouble de stress post-traumatique » en est bel et bien à sa quatrième décennie en tant que catégorie de diagnostic psychiatrique établi, son acronyme « TSPT » déjà bien ancré dans notre vocabulaire. Et pourtant, à l’extérieur de la communauté des thérapeutes professionnels, la plupart des gens associent encore exclusivement le TSPT aux vétérans des conflits armés à grande échelle. La condition a d’abord été identifiée chez les anciens soldats de champs de bataille, et les organisations de défense des droits des anciens combattants sont de plus en plus virulentes et actives et exigent une prise de conscience, des traitement et une compensation. La reconnaissance d’un traumatisme psychologique chez les anciens combattants n’est cependant pas venue facilement, et un bref regard sur cette histoire nous aidera à mieux comprendre la route encore parsemée d’embûche vers la reconnaissance du TSPT chez les policiers d’aujourd’hui.
Il est possible que, de tous les temps, il y ait eu des soldats qui souffraient de ce que nous appelons maintenant le TSPT, et bien avant l’attribution du terme, il avait été largement observé que les soldats en souffraient non seulement durant la guerre, mais par la suite.
Au XVIIe siècle, des médecins allemands qualifiaient ce phénomène de Heimweh, qui signifie le mal du pays, tandis que les Français l’appelaient la maladie du pays. En Espagne, la condition était appelée estar roto, qui signifie être brisé.
Durant la guerre de sécession, l’angoisse physique et mentale des soldats était appelée « le trouble affectif du soldat »; son nom plus commun parmi les vétérans de la Première Guerre mondiale était « l’Obusite » (bien que ceux qui en ont été atteints –criant, pleurant sauvagement ou devenant muet – n’avaient pas tous vécu le choc de l’explosion des obus); et suite à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée, le terme utilisé était la « névrose des tranchées » ou « l’épuisement au combat ».
Chacun des événements ci-dessus suscitait un intérêt temporaire, durant la période de temps de guerre, pour ce qui se passait chez les soldats qui craquaient et étaient incapables de se battre. Mais après la fin de chaque guerre, l’intérêt et l’attention s’estompaient en grande partie. Les institutions et les professions de la société hésitaient à déplacer la guerre et son sillage patriotique de sa fière et sacro-sainte tablette (les policiers psychologiquement blessés dans l’exercice de leurs fonctions étaient loués pour leur bravoure mais devaient toutefois guérir rapidement – s’ils devaient guérir de quoi que ce soit).
Jusque dans les années 1960, il n’était pas considéré « viril » pour un soldat d’admettre des traumatismes psychologiques causés par le combat (même en tant que policiers, les hommes comme les femmes ont encore parfois honte d’admettre des symptômes de traumatisme). Pendant la guerre de sécession, des allégations de détresse psychologique étaient synonyme de lâcheté et de désertion, dont la peine était la pendaison. Les soldats de la Première Guerre mondiale en France et en Angleterre qui admettaient souffrir d’obusite étaient soumis à des traitements par électrochocs et – ici encore – étaient accusés de lâcheté. Après la Seconde Guerre mondiale, malgré les taux élevé de divorce et d’alcoolisme chez les anciens combattants qui rentraient à la maison, le mythe inventé était celui du soldat bien ajusté qui rentrait à la maison après une « bonne guerre » et se réintégrait sans heurt dans la vie civile; les symptômes de traumatisme étaient balayés et laissés sans traitement. Selon l’avis qui a prévalu, les hommes allaient à la guerre, agissaient avec courage pour servir leur pays et étaient fiers et heureux d’être accueillis par la suite à la maison par une nation reconnaissante.
Toutefois, dans les années 1960 et 70, un certain nombre de facteurs se sont imbriqués pour finalement ouvrir de nouvelles portes à la compréhension et au traitement des anciens combattants traumatisés de la guerre du Vietnam.
Dans un premier temps, des scènes de guerre très explicites étaient diffusées tous les soirs à la télé tandis que la guerre se poursuivait. Ces scènes ne pouvaient pas transmettre la totalité de l’expérience de combat vécue, mais les images n’étaient pas assainies et le grand public, bien qu’à l’abri de la guerre par une grande distance sécuritaire, pouvait voir et ressentir l’horreur vécue par les soldats. Par ailleurs, la guerre terminée, le sentiment populaire aux États-Unis et parmi ses alliés s’était retourné contre l’effort de guerre, libérant pour une première fois l’espace public afin que les anciens combattants puissent parler des méfaits de la guerre sur leur propre psyché.
De façon précaire, également, les anciens combattants du Vietnam aux États-Unis ont commencé à s’organiser eux-mêmes à l’extérieur de l’établissement guindé de l’Administration des anciens combattants du gouvernement et des vieilles organisations d’anciens combattants traditionalistes. Dans un climat ouvert par la décennie de protestation sociale et de questionnement des années 1960, certains anciens combattants mécontents, y compris des soldats hautement décorés, ont fondé l’organisation Vietnam Veterans Against the War (Anciens combattants du Vietnam contre la guerre). Une de leurs activités consistait à organiser des « groupes de discussion » et d’entraide où des anciens soldats se réunissaient pour parler de leurs expériences, tant pendant la guerre que par la suite.
C’est là, lors de ces rencontres, que les hommes ont pour la première fois commencé à se parler entre eux, au-delà des sentiments de honte et des étiquettes de lâcheté, de leurs fréquents cauchemars et flash-backs et de leur difficulté à se réadapter à une vie « normale ». (Cela, et ce n’est certainement pas par hasard, a suivi la renaissance du mouvement pour l’émancipation de la femme, avec la remise en cause des rôles et des qualités traditionnels des sexes masculin et féminin, et son initiation au format « groupe de discussion », au sein duquel les femmes se parlaient ouvertement l’une à l’autre. De nos jours, un des éléments clés du processus de guérison chez les policiers souffrant de TSPT est souvent le soutien obtenu de leurs homologues dans les groupes de discussion.)
À la fin des années 1970, la Veterans Administration des États-Unis a elle-même répondu en organisant des centres d’encadrement et de consultation par les pairs à l’échelle nationale et en finançant des études psychiatriques détaillées sur l’incidence de la guerre sur les anciens combattants de retour à la vie civile. C’est en fait, en grande partie, sur la base de ces études qu’en 1980, l’American Psychiatric Association a finalement introduite une nouvelle catégorie diagnostique dans son Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le terme utilisé pour désigner la série de symptômes étudiés chez les anciens combattants traumatisés et les victimes de catastrophes était « trouble de stress post-traumatique ».
Qu’est-ce qu’un traumatisme, et quels sont les symptômes de TSPT?
Au XXIe siècle, la plupart des adultes a déjà vécu une quelconque expérience de stress. En effet, nous supposons souvent que le stress est une composante inévitable du quotidien dans notre monde moderne et post-moderne. Le stress cumulatif, ou l’épuisement professionnel, n’est également pas rare. Mais le stress traumatique, pour la plupart d’entre nous, ne fait pas partie de notre vie de tous les jours.
Un événement traumatique en est un d’une telle ampleur, d’une telle puissance et d’une telle signification qu’il transcende la capacité normale d’une personne à intégrer et à faire face à la réalité. Son sentiment fondamental d’un monde sécuritaire est paralysé ou anéanti, peu importe la distance ou le temps écoulé depuis le traumatisme.
Un événement traumatique implique généralement au moins la menace de blessures graves ou de mort (et souvent des blessures physiques à la personne traumatisée et/ou le décès d’autres personnes), s’accompagne de sensations de peur intense, de choc, d’horreur et de vulnérabilité.
Le trouble de stress post-traumatique peut être une conséquence d’un épisode traumatique unique ou d’une série de tels événements. Ce n’est pas anormal, ni une maladie ni de la lâcheté, mais bien une réaction humaine normale à une situation anormale. (Les thérapeutes ont identifié un certain nombre de facteurs qui peuvent prédisposer une personne à développer un TSPT en réponse à un événement traumatique. Ceux-ci incluent les dimensions de la personnalité, tel que l’exposition antérieure à des traumatismes ou autres agents stressants de la vie, et les facteurs environnementaux, y compris la réponse organisationnelle et communautaire. Cependant, il n’existe aucune description d’un type de personne qui soit particulièrement sujet au TSPT, et des termes controversés tels que « faiblesse mentale » ou « lâcheté » n’apportent aucune lumière.
Le TSPT se décline en trois groupes de symptômes. Une personne peut recevoir un diagnostic de TSPT si elle souffre de symptômes persistants de chacun des trois groupes, et que ces symptômes l’empêchent de mener une vie normale au quotidien (prendre soin d’elle-même selon le besoin et interagir de manière continue et saine avec sa famille, ses amis et la société).
Le premier groupe de symptômes s’articule autour de la reviviscence de l’événement traumatique. Cela peut se produire par l’éveil de pensées et de souvenirs qui ne peuvent être bannis de l’esprit, ou en revivant l’événement en cauchemars. L’exposition à des bruits ou à des odeurs qui rappellent ou symbolisent l’événement peut entraîner des épisodes d’anxiété et d’adrénaline intenses et des réactions « de lutte ou de fuite ». Les flash-backs sont
également fréquents. Bien plus que de simples souvenirs, les flash-backs sont une reviviscence vivide de l’événement, dans toute son horreur; la personne a littéralement l’impression que l’événement se reproduit à nouveau et peut physiquement agir de la manière « appropriée ».
Différents types de comportement d’évitement forment le deuxième groupe de symptômes du TSPT, tels que des réactions d’engourdissement, alors que la personne se referme sur sa blessure psychologique et s’isole de toute interaction avec le monde. Elle est incapable de se comporter comme avant avec ses proches ou de pratiquer des activités qui lui plaisaient auparavant; elle ne peut parler (ou souvent ne peut se rappeler) du traumatisme ou exprimer ses émotions; elle peut ressentir une culpabilité extrême ou de la dépression et ne peut entrevoir un avenir heureux.
La troisième et dernière pléiade de symptômes peut sembler non conforme à la précédente, alors que la personne souffrant de TSPT adoptera à l’occasion un comportement contraire : une excitation accrue, des réactions exagérées à de grands bruits, de l’insomnie, des explosions de colère.
Les symptômes de TSPT peuvent apparaître immédiatement après un épisode traumatique ou être décalés de plusieurs mois, voire des années (peut-être par automédication – par des moyens tels que les drogues, l’alcool ou la dépendance au sexe.). Il y a une discussion continue parmi les thérapeutes quant à savoir si quelqu’un qui vit un « TSPT à retardement » présente réellement des symptômes pour la première fois après tant de mois ou d’années, ou si les symptômes sont apparus plus tôt et ont été ignorés et réprimés.
Dans CopShock : Surviving Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Allen R. Kates aborde la question des agents de police qui ne présentent aucun symptôme apparent après un incident traumatisant, mais souffrent plus tard de TSPT. Dans la seconde édition de l’ouvrage (2008) (le premier ayant été publié en 1999), il fait le récit de Jonathan Figueroa, l’agent de police de New York qui était présent lors de la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001. Son beau-frère était décédé sur les lieux, et Jonathan Figueroa a travaillé pendant des mois à fouiller dans les tas de décombres. Il faisait aussi partie des premiers intervenants lors de l’explosion de l’avion de ligne en novembre 2001, alors que des corps calcinés et des parties de corps humains tombaient du ciel sur Long Island. Néanmoins, ce n’est que cinq années plus tard, tandis qu’il visitait à l’hôpital un collègue policier heurté par un véhicule, que Jonathan, selon ses propres mots, « s’est senti angoissé et que tout s’est mis à tourbillonner. J’ai commencé à trembler et à me sentir nerveux et, dès ce jour-là, j’ai perdu contrôle et tous les événements du passé ont refait surface : le 9 septembre, l’écrasement de l’avion, mon beau-frère, le premier homicide dont j’ai été témoin à l’époque où j’étais recrue. »
Reconnaître le TSPT chez les policiers
Allen R. Kates adapté son chapitre sur Jonathan Figueroa dans CopShock pour un article en ligne publié sur www.PoliceOne.com, « PTSD can attack years later » (Le TSPT peut attaquer des années plus tard) (23 avril 2009). Dans son article, il explique les raisons sous-jacentes possibles de l’apparition à retardement des symptômes du TSPT. L’agent Jonathan Figueroa se souvient de sa propre réaction, et des réactions de ses collègues le 9 septembre : « Nous étions au travail, et pendant les pauses, nous n’en parlions pas. Pas question. C’est dégueulasse. Parler de nos sentiments, de nos émotions? Vous êtes une lavette si vous le faites parce que nous sommes des hommes virils, des policiers, nous pouvons affronter n’importe quoi. Vous vous coupez de vos émotions. »
Les agents de police, à leurs propres yeux et aux yeux des autres, sont censés être forts et en contrôle – en contrôle d’une situation, en contrôle d’eux-mêmes. Ils sont considérés comme des solutionneurs de problèmes; ils ne sont pas censés avoir des problèmes. Ils débutent leur carrière en sachant que – dans les grandes villes certainement et, de plus en plus, peu importe où – le travail du policier suppose des interactions avec de la violence. De la violence souvent brutale. De la mort souvent brutale.
Mais les policiers sont des êtres humains, avec leur bagage de personnalités individuelles comme nous tous : des forces et des faiblesses, des désirs et des besoins, de la compassion et de la douleur, des egos et des vulnérabilités. La conscience intellectuelle de la violence dans le travail policier ne suffit pas à le préparer adéquatement à la réalité, sans même parler des dangereux affrontements avec des criminels armés, des rapports après le fait qui doivent être lus, décrivant les horribles détails de viols et de meurtres, de jeunes enfants gravement battus et meurtris (dont les parents prétendent une chute accidentelle), d’accidents de voiture avec des corps mutilés, de catastrophes et de décès prématurés. Le traumatisme peut être le résultat d’un incident unique, ou un incident peut faire basculer la longue accumulation de violence et de douleur vécue au quotidien.
Bien que les mentalités évoluent, la situation actuelle pour les policiers traumatisés ressemble encore trop souvent à l’état des soldats des champs de bataille au cours des dernières décennies : les difficultés psychologiques sont considérées comme de la faiblesse, de l’incompétence ou même de la lâcheté (bien que cela n’ait rien à voir). Cette attitude, généralement, a été englobée par le policier lui-même et l’empêche ainsi de faire le geste dont il a le plus besoin : demander de l’aide.
Il y a quatre ans et demi, le 14 avril 2010, le journaliste Mark Bonokoski écrivait la première d’une longue série de rubriques novatrices dans le Toronto Sun intitulée « Breaking the code of silence » (Rompre le silence). L’article commençait par le récit du suicide du sergent de police Eddie Adamson en 2005, et de la décision de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) en 2009 selon laquelle sa mort aurait été causée par le TSPT.
« La terminologie et la pensée à l’ancienne l’avaient décrit comme souffrant ‘d’épuisement professionnel’ ou ‘d’épuisement au combat’ », a écrit Mark Bonokoski, « et avait donc favorisé l’illusion que l’on pouvait se débarrasser de cet état d’esprit simplement en y mettant de la bonne volonté. »
Mais il poursuit : « L’adjudicateur du processus d’appel de la CSPAAT, Mark Evans, a définitivement conclu qu’Eddie Adamson avait « souffert d’une réaction post-traumatique aiguë en obéissant à l’ordre de ne pas intervenir et en arrivant trop tard pour sauver la vie du jeune constable Sweet. À partir de ce jour, le cheminement vers son suicide était médicalement compréhensible, explicable cliniquement, et donc pratiquement prévisible. En d’autres termes, il est littéralement décédé dans l’exercice de ses fonctions. »
Cette année-là, Mark Bonokoski a écrit une série d’articles sur la police et le TSPT, remportant un prix décerné par le Tema Conter Memorial Trust, un organisme national à but non lucratif qui fournit un soutien psychologique et par les pairs au personnel militaire et aux premiers intervenants. La série a contribué à faire connaître le cas de Bruce Kruger, parti à la retraite après 29 ans de service auprès de la Police provinciale de l’Ontario, et qui avait divulgué publiquement son duel personnel aux prises avec le TSPT et sa critique de l’OPP quant à leur réponse inadéquate aux traumatismes et à la maladie mentale.
Bruce Kruger s’est adressé à l’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, et, quand sa campagne a gagné de la visibilité, des dizaines d’autres policiers de l’Ontario lui ont emboîté le pas. En 2012, André Marin a publié un rapport de 150 pages, une critique torride de la Police provinciale de l’Ontario pour sa mauvaise gestion des cas de TSPT dans ses rangs. Le rapport s’ouvre sur l’austère récit du suicide du sergent Douglas William James Marshall, un policier de la PPO de 45 ans, et poursuit :
« Les dirigeants de la PPO soutiennent que la culture policière a évolué, que les lésions induites par un traumatisme ne sont plus perçues comme un signe de faiblesse, et qu’un grand soutien est disponible pour les agents affectés ». Mais les tabous sociaux entourant la maladie mentale et le suicide sont implacables.
« Au cours de cette enquête, nous avons été contactés par de nombreux agents courageux, actifs et retraités, qui ont été touchés et affligés par des traumatismes liés au stress opérationnel. Nous avons entendu à maintes reprises que, bien que la PPO ait progressé ces dernières années dans le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel grâce à la formation et à l’éducation, la stigmatisation entourant la maladie mentale est toujours aiguë et continue d’empêcher les membres de demander de l’aide. Les policiers souffrant de traumatismes liés au stress opérationnel sont souvent isolés, ridiculisés et marginalisés par leurs pairs, et se sentent régulièrement non soutenus par la direction, ainsi que dévalués lorsqu’ils retournent au travail dans des postes adaptés. »
En avril 2010, dans son article initial, Mark Bonokoski parlait de façon encourageante que le personnel du Service de police de Toronto comptait deux psychologues à plein temps. Et pourtant, il a conclu l’article sur une note d’avertissement, citant les propos d’un des psychologues, le Dr Carol Vipari : « Les mentalités évoluent. L’acceptation est croissante. Nous voudrions tous que cela se fasse rapidement. Mais aucune organisation ne migre du jour au lendemain. »
Oui, les mentalités évoluent. Oui l’acceptation est croissante. Des articles et des livres complets ont été écrits, notamment par des policiers eux-mêmes, brisant la honte, le silence et les tabous. (Voir l’encadré pour un échantillon de lecture). Mais le problème demeure pourtant grave, tel que démontré le 17 juillet 2014 dans la première phrase d’une publication de James Armstron sur le site Web de Global News : « Deux autres des premiers intervenants du Canada se sont enlevés la vie cette semaine, portant le nombre total de suicides par des ambulanciers, pompiers, policiers, répartiteurs et personnel pénitentiaire canadiens à 13 en moins de dix semaines. »
Il poursuit : « Ces révélations surviennent alors que le gouvernement de l’Ontario tente de comprendre quelles mesures les institutions publiques peuvent prendre pour faire face au trouble de stress post-traumatique et à la ma maladie mentale chez les Canadiens dont le travail consiste à se précipiter vers des situations violentes et traumatisantes tandis que tout le monde fuit en sens inverse. »
Demander de l’aide
Le stress post-traumatique n’est pas une maladie uniformisée. Ses causes, ses symptômes et ses traitements seront différents. Bien qu’il y ait un consensus général quant à la définition d’un événement traumatique et des trois groupes de symptômes du TSPT (décrits plus haut), des discussions sont en cours parmi les thérapeutes à savoir si la désignation est devenue un fourre-tout pour un large éventail d’affections qui pourraient être mieux comprises si différenciées.

Le psychothérapeute Edward Tick, dans son livre War and the Soul: Healing Our Nation Veterans from Post-traumatic Stress Disorder, a écrit que, basé sur ses longues années de travail auprès d’anciens combattants et de civils qui ont survécus aux atrocités de la guerre, il est en désaccord avec le fait que le « TSPT » soit, en fait, mieux caractérisé comme étant un « trouble de stress ». « Au contraire », écrit-il, « il est mieux compris comme un trouble de l’identité et une blessure de l’âme, affectant la personnalité de l’individu à son niveau le plus profond… Après la guerre ou toute autre perte traumatique, nous demeurons changés à jamais. Nous ne pouvons ni retrouver notre essence initiale ni retourner à un état d’innocence… »
Le Dr Tick cite un ancien combattant avec qui il a travaillé et qui préfère l’ancien terme « trouble affectif du soldat », car « TSPT est une maladie de bon guerrier. »
Étant donné les discussions en cours et les points de vue divergents quant à la nature de la maladie appelée « TSPT », il n’est pas surprenant que différents professionnels de la santé mentale offrent comme traitement des formes variées de traitements, de la thérapie par le dialogue à la médication, en passant par l’hypnose. Il serait hors de la portée de cet article d’examiner toute la question de ces différents points de vue et thérapies, mais ce qui est important est de souligner ici ce qu’Allen R. Kates écrit dans CopShock : « Police officers cannot manage PTSD on their own, but healing is possible » (Les agents de police ne peuvent gérer le TSPT par eux-mêmes, mais la guérison est possible.)
Personne ne peut gérer le TSPT (peu importe comment il est défini, ou là où la victime se trouve sur le spectre) par sa propre initiative. Mais la guérison est possible.
Il est essentiel de connaître ces deux affirmations et de les retenir.
Guérir du TSPT signifie que la personne traumatisée ne se sent plus une victime sans défense dont la vie a échappé à tout contrôle, mais plutôt comme une survivante, quelqu’un qui a intégré l’incident ou les événements traumatiques dans la globalité de sa vie. (Dans War and the Soul, Edward Tick parle de « la reconstruction de l’identité d’un survivant, de l’ancien combattant au guerrier » par « le développement d’une nouvelle identité assez forte et compatissante pour panser la plaie et guérir l’âme. »)
Un survivant d’un traumatisme pourrait, ou non, trouver un sens ou une fin à l’expérience mais, quel que soit le cas, il sera capable de se rappeler l’événement, de gérer émotivement les sentiments générés par les souvenirs – et de passer ensuite à autre chose. L’estime de soi, la compétence et la foi en l’avenir auront été restaurés.
Un survivant de TSPT peut vivre des rechutes. D’importants rappels de l’événement, ou une date anniversaire peuvent encore s’avérer difficiles. Mais le survivant sera préparé à ces défis, et saura comment et où aller chercher l’aide et le soutien dont il a besoin pour que la rechute ne soit que temporaire.

Chercher et demander de l’aide et du soutien est, en fait, la première étape sur la voie du rétablissement. Le TSPT ne peut s’automédicamenter par le déni, les drogues ou l’alcool, les jeux de hasard ou le sexe. Ceux-ci peuvent réprimer temporairement les symptômes, mais le mal est toujours à l’intérieur, et plus on l’ignore, plus il s’aggrave.
La plupart des commentateurs sur le TSPT des policiers sont d’avis que l’aide d’un thérapeute expérimenté en consultations aux victimes de traumatismes (et préférablement quelqu’un qui a déjà travaillé avec des premiers intervenants) est essentielle à la guérison quand le stress et les traumatismes sont devenus un TSPT à proprement parler. (Le site Web Trauma & PTSD contient une page de ressources canadiennes pour le traitement du TSPT, d’hôpitaux et de centres de services sociaux, et de psychologues de pratique privée, répertoriés par province : http://www.trauma-ptsd.com/fr/ressources.)
Si, toutefois, l’idée de « voir un psy » rend inconfortable, même (ou surtout?) si le personnel du service compte un psychologue, ce n’est pas automatiquement le premier pas que doit faire le policier traumatisé. L’essentiel est qu’il reconnaisse qu’il a besoin d’aide et qu’il n’a pas à avoir honte. L’essentiel est qu’il passe à l’étape de rechercher de l’aide. En 2014, les ressources sont nombreuses.
Les groupes de soutien par les pairs policiers sont la première bouée de sauvetage de nombreux agents qui vivent des symptômes de stress post-traumatique. Dans un groupe de pairs, un policier peut rencontrer et parler ouvertement, sans culpabilité ni honte, avec d’autres qui ont vécu une expérience similaire. Ceux qui y sont passés avant lui peuvent le guider dans sa voie vers le rétablissement. Ces groupes ou réseaux existent dans de nombreuses collectivités canadiennes, parfois dans le service de police lui-même, et parfois plus officieusement, en dehors de l’égide du service. (Le livre 56 Seconds par le sergent d’état-major à la retraite Syd Gravel propose des lignes directrices pour la création d’un réseau de soutien par les pairs, pour les endroits où il n’en existe aucun.)
Si un policier qui a vécu un traumatisme ne connait pas un réseau local, ou hésite tout d’abord à communiquer avec des collègues qu’il connaît, plusieurs organismes peuvent lui proposer les ressources nécessaires pour sa guérison. Les deux organismes les plus complets sont :
Badge of Life Canada (http://badgeoflifecanada.com/), dessert « les policiers actifs et retraités municipaux et provinciaux canadiens, les répartiteurs du 911, le personnel de soutien civil et les familles de tous ces membres des services policiers. » Le site Web déclare : « Badge of Life Canada fournit aux individus un lieux sûr où aller chercher un soutien direct par l’établissement de liens positifs avec des pairs bénévoles, des survivants de traumatismes et de TSPT et/ou des professionnels de première ligne. »
Tema Conter Memorial Trust (http://www.tema.ca/), dont la devise est « Nous venons en aide à ceux qui consacre leur vie à vous aider ! » Ils affirment : « Par le biais de la recherche, de l’éducation et de la formation et en assurant un soutien psychologique et par des pairs, nous aspirons à aider les hommes et les femmes de la sécurité publique et d’organismes militaires au Canada quand ils en ont le plus besoin ».
« Nous sommes là pour vous », affirme le site Web Badge of Life Canada.
À ceux qui souffrent du trouble affectif du soldat : vous n’avez pas à être seul.
— Michelle Gubbay est rédactrice à la pige. Née à Winnipeg, elle a grandi à Montréal et elle vit présentement à Los Angeles. Vous pouvez la joindre à mrglaca@gmail.com.